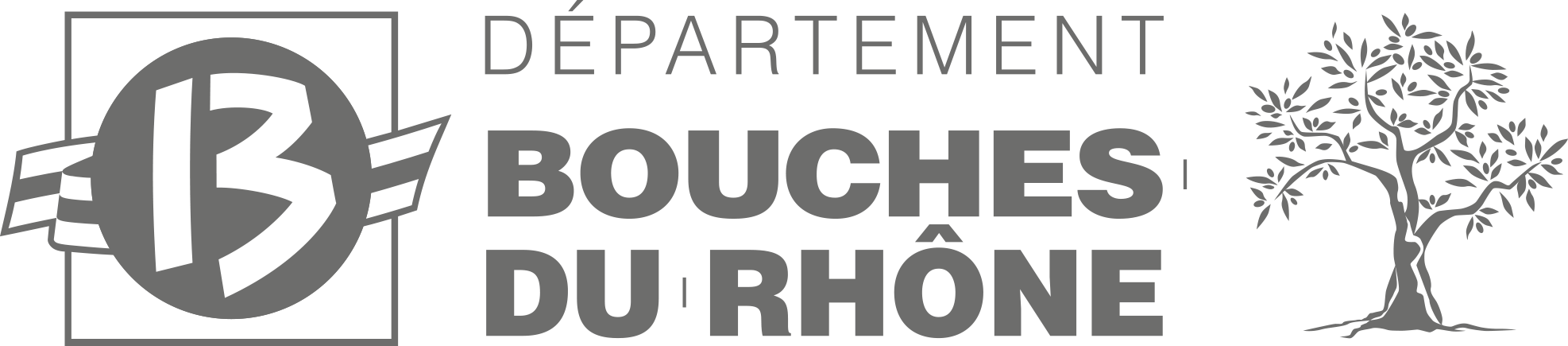Les bibliothèques se mettent au vert
Publié le 26/05/2025
Dans le cadre du projet de recherche « Décarboner le livre et l’édition », piloté par le Bureau des acclimatations et l’Université de Grenoble-Alpes, une étude a été menée concernant les établissements de lecture publique.
Ce rapport, intitulé Mesurer et réduire les consommations d’énergie en bibliothèque a été écrit par Fanny Valembois, chercheuse indépendante, consultante et formatrice, spécialiste des démarches de décarbonation des organisations culturelles.
Le constat qui ressort tout d’abord de cette analyse est que peu de structures françaises ont réalisé et publié leur bilan carbone. Il n’existe donc pas de référentiel type. Trois bibliothèques (anonymes) font ici office de points de repères : deux municipales et une universitaire. « Avec des émissions représentant entre 22 % et 50 % des émissions totales, l’énergie est une des causes principales d’émissions de gaz à effet de serre (GES) (…) Dans les exemples cités, si la priorité est de réduire les émissions de GES, c’est sur le chauffage qu’il faut agir en priorité. Si par contre, la priorité est de réduire la consommation d’énergie (…) il sera nécessaire d’agir à la fois sur la consommation d’électricité et de gaz ».
Première étape : mesurer
Mesurer et suivre l’évolution de ses dépenses dans le temps semble indispensable pour plusieurs raisons :
- Comprendre ce qui utilise le plus d’énergie (quels appareils, à quel moment de la journée ou de l’année).
- Vérifier si les actions de réduction qu’on met en place sont efficaces ou pas.
- Comparer avec des chiffres moyens par rapport à d’autres établissements, pour se situer.
Or, le document met en avant, dès les premières pages, une difficulté largement partagée : la méconnaissance, par les personnels, des réels besoins énergétiques de leur bâtiment.
Afin de mieux cerner le contexte et comprendre les raisons d’un tel manquement, l’étude a exploité deux sources différentes de données : les réponses issues d’une enquête menée auprès de 101 établissements et celles provenant de deux ateliers de mesure en temps réel.
Plusieurs observations découlent de ces investigations :
- Les informations sont peu disponibles (absence de compteur et d’accès aux factures) et peu fiables (mélange d’unités, périodes de mesure variant d’une année à l’autre).
- Les causes des dépenses énergétiques varient fortement d’un site à l’autre en fonction de divers facteurs : le mode de chauffage, le type de bâtiment, la surface, les heures d’ouverture, les installations (climatisation, chauffage), etc.
Un enjeu très fort est ainsi mis en avant : il s’agit de s’organiser pour pouvoir accéder à des données sûres et régulières.
Deuxième étape : trouver des solutions concrètes
L’analyse apporte des réponses à la question : « Que faire, quand on ne peut pas faire de travaux ? ».
Afin de diminuer la consommation électrique, il est suggéré de porter attention à plusieurs points :
- L’éclairage (baisser la luminosité, supprimer les lampes inutiles, utiliser des ampoules adaptées…).
- La ventilation (vérifier que le débit est adapté aux volumes et que l’entretien est effectué régulièrement…).
- L’eau chaude (baisser la température de consigne, isoler le ballon et les conduites…).
- Le parc informatique (éteindre tous les appareils non utilisés…).
La réduction du chauffage semble également indispensable. En effet, celui-ci constitue une part importante, tant dans la dépense énergétique que dans les émissions de gaz à effet de serre. Il est ici conseillé de ne pas chauffer partout par exemple mais également de baisser la température lorsque la météo le permet.
Troisième étape : proposer des outils de mise en application
« Pour faciliter l’appropriation des informations contenues dans ce rapport, nous avons créé trois ressources qui peuvent être prises en main de manière autonome par toute personne qui souhaite initier ou animer une démarche de réduction des consommations d’énergie » :
- Un jeu type « Timeline » pour comprendre les ordres de grandeur du bilan carbone, avec une dizaine de cartes à imprimer ou à reproduire à la main.
- « Un protocole de relevé des données en temps réel » : un déroulé-type présenté de façon détaillée a été créé afin de donner la possibilité aux structures qui le souhaitent d’effectuer ce décompte.
- Un atelier « Un hiver en bibliothèque » qui permet de discuter en équipe des leviers d’action pertinents.
Autant de méthodes et de pistes de réflexions qui encouragent les établissements de lecture publique à évoluer vers des comportements plus écologiques et économiques.